Un roman du 93, ce livre l’est à double titre. D’abord parce que l’histoire s’inspire du parcours d’un personnage réel, jeune délinquant de Saint-Denis surnommé le Marseillais. Ensuite parce que l’auteur est un enfant du cru. A 37 ans, Rachid Santaki n’a jamais quitté le nord de la Seine-Saint-Denis. Il habite La Courneuve, et a grandi entre Saint-Ouen et Saint-Denis, au rythme des entraînements de boxe et des débuts du rap.
Le langage des cités
Cette culture urbaine lui colle décidément à la peau. Après avoir dirigé pendant plusieurs années le magazine gratuit « 5Styles », dédié à la culture hip-hop, ce jeune père de famille veut désormais ouvrir une nouvelle voie : celle de l’écriture. « Aux Etats-Unis, les rappeurs ont influencé des auteurs. Il faut désacraliser l’écriture », estime-t-il, citant volontiers l’Américain George Pelecanos, dont les romans plongent dans les bas-fonds de Washington.
Rachid Santaki n’en est pas à son coup d’essai. Son premier récit a été publié en 2008, sous le titre « Ma petite cité dans la prairie ». Il y expérimentait déjà une écriture très orale, puisant dans le langage des cités. Cette fois encore, le récit emprunte au verlan et aux expressions propres au 93. « C’est un livre qui parle de la banlieue avec son langage et ses codes », estime Hector Paoli, l’un des éditeurs. Préfacé par le rappeur Oxmo Puccino, ce livre trouvera-t-il son public ? La promo, par le biais des affiches et du blog littéraire de Rachid Santaki, semble avoir fonctionné. « J’ai croisé plusieurs jeunes de Saint-Denis qui me demandent : Alors, le livre sur le Marseillais, il sort quand ? confie Rachid. Si on arrive à réconcilier les plus jeunes avec la lecture, ils s’intéresseront aussi aux classiques. »
Avec ses éditeurs, Rachid Santaki espère surtout ouvrir la voie à d’autres écrivains en puissance. Ensemble, ils ont fondé une nouvelle collection dédiée à la littérature urbaine, le Syndikat. Les premiers textes, courts, seront d’abord publiés sur Internet, puis dans une revue. « Quand la littérature s’éloigne de la rue, il y a toujours quelqu’un pour l’y ramener », assure Hector Paoli.
* Racaille, en verlan.
« Les Anges s’habillent en caillera », de Rachid Santaki, Editions Moisson rouge, 18 €.
mercredi 28 décembre 2011
Pour Noël, des manifs russes
Extrait de Retour à la case départ de Vladimir Kozlov, à paraître en janvier 2012.
vendredi 9 décembre 2011
Chronique de Jaguars de Sophie Di Ricci sur Polarnoir
Samuel Mazeau, l'aîné, et son frère Jonathan ont été durant quelques mois et le temps d'un album des stars de la mouvance punk-rock, jusqu'au jour où, durant une tournée, Jon a fait une overdose.
Depuis ils se sont repliés du côté de Rive-de-Gier, non loin de Saint-Étienne, là où vit leur mère. Sam cohabite tant bien que mal avec sa copine Zoé et vivote à coup de RMI dans une parano révolutionnaire de pacotille, laissant libre cours à sa fascination pour les armes, tandis de Jon suit un programme de désintoxication à base de méthadone et s'est installé chez sa mère. Pour eux, la musique, c'est terminé.
A la suite d'une altercation à propos de leur chien sur une terrasse de restaurant, ils font la connaissance de Godzilla — sorte de monstre acnéique homosexuel — à qui Jon a tapé dans l'œil. Godzilla est en mission, sans doute pour tuer quelqu'un, mais à son retour vers Paris, il fait un arrêt pour retrouver Jon et savourer une étreinte rapide.
Pour Jon, qui se débat dans sa cure déprimante, c'est un éclair de jouvence ; pour Sam, qui vient de se faire virer par son proprio, c'est l'occasion de monter à Paris puisque Godzilla vient d'y inviter son frère. Pourtant, pour leur seconde rencontre, c'est seul que Jon se rendra à la capitale ; un événement vécu comme une trahison par son frère…
La première chose qui frappe à la lecture de Jaguars — et lorsqu'on a déjà connu Moi comme les Chiens, le précédent et premier roman de Sophie Di Ricci — ce sont certaines similitudes dans l'ambiance et les personnages : la jeunesse de ces derniers, le fait qu'il s'agissent d'hommes, que l'un d'eux soit homosexuel, que la drogue ne soit jamais très loin et qu'ils naviguent plus ou moins en milieu underground. Alors on se dit qu'on est parti pour une suite, ou un prolongement de cette première expérience et de fait, Sophie Di Ricci reconnaît elle-même qu'elle poursuit ici une sorte de portrait, celui de la progéniture des freaks des années soixante, soixante-dix, représentée ici par la mère de Sam et Jon (Sam aurait été lui-même conçu sous l'emprise de l'héroïne). Pour autant, les différences se font bientôt sentir. À l'incroyable solitude d'Alan (narrateur de Moi comme les Chiens) succède le mal-être de Jon et sa quête de "normalité" symbolisée par la stabilité d'une épaule solide.
Le problème est sans doute que cette épaule est celle de Godzilla, trafiquant de drogue, un tueur esthète et autoritaire. Malgré cela, c'est une histoire d'amour qui se noue entre les deux hommes, une histoire peu ordinaire, à la "je t'aime, moi non plus", mais une histoire puissante, sensuelle.
Sophie Di Ricci construit son roman à coup de scènes rapides, dans un découpage quasiment cinématographie privilégiant les dialogues (et la langue fleurie), et nous donne à lire comme un road-polar immobile, une sorte de chronique du temps qui passe dans cet underground décalé où rien n'est jamais acquis. Le style tend vers la simplicité et l'efficacité. L'environnement est sordide — que ce soit les scènes en compagnie de la mère ou celles se situant dans le cinéma désaffecté qui sert de QG à Godzilla — mais Jon s'accroche coûte que coûte à son rêve impossible.
À ses côtés, son inséparable frère, celui qui joue à l'homme mais se retrouve perdu dès que son cadet n'est plus à portée de regard, ce révolutionnaire en chambre, ce manipulateur de pacotille, ce mec comme les autres quoi, par qui tous les malheurs arrivent…Jaguars est une longue et inexorable glissade vers le fond du trou, éclairée par quelques éclairs de sensualité brute. Si Sophie Di Ricci s'attache avant tout à ses personnages, à leurs vies et à leurs amours, son roman dresse cependant, loin de toute entreprise sociologique, le portrait anecdotique, de l'intérieur, d'une certaine jeunesse et c'est sans doute, au final, ce qui fait son intérêt.
jeudi 8 décembre 2011
Interview de Sophie Di Ricci par Baptiste Madamour
24 Novembre 2011
Du noir dans les veines (.fr)
 « Gibert
Platier avait vu juste. Godzilla aussi. Ils étaient des amateurs. Ils
n’y connaissaient rien. Deux Al Capone clochardisés, en virée dans
l’underground lumpenprolétaire. Politiquement, ils étaient des bouffons.
« Gibert
Platier avait vu juste. Godzilla aussi. Ils étaient des amateurs. Ils
n’y connaissaient rien. Deux Al Capone clochardisés, en virée dans
l’underground lumpenprolétaire. Politiquement, ils étaient des bouffons.
- J’ai juste sniffé. Une toute petite trace. C’est pas grave.
- Si c’est grave. Tu fais chier !
- Sam, je voulais tester sa dope. Pour voir s’il était aussi influent qu’il le prétend et…
- Ça me tue que tu fasses comme nos putain de vieux ! Ils t’ont pas servi d’exemple, merde ? »
Sophie Di Ricci, Jaguars.
Sophie Di Ricci écrit du roman noir sans s’en rendre compte, mais son
écriture directe, rythmée apporte un nouveau souffle dans le genre, un
souffle fait de violence, de moiteur, de désespoir et de tendresse dans
une littérature qui devient de plus en plus aseptisée.
Face à la mode de ces romans policiers à l’ancienne avec un flic, un crime horrible, une enquête et tout qui rentre dans l’ordre à la fin, les livres de Sophie Di Ricci font tâches, comme dans tout bon roman noir, elle écrit de l’autre côté de la matraque, avec une spontanéité que l’on retrouve dans cet entretien qui s’est déroulé aux journées Sang d’Encre de Vienne en novembre 2011.
Son dernier livre paru, Jaguars publié par les éditions Moisson Rouge, raconte l’histoire de deux frères déphasés, anciens membres d’un groupe punk et de leur rencontre avec un petit mafieux peut-être encore plus déjanté qu’eux.
BM : Comment êtes-vous arrivée au roman noir ?
Sophie Di Ricci : J’ai toujours écrit des trucs assez violents avec des meurtres et des beaux mecs, mais je ne savais pas que c’était du roman noir en fait. J’ai fini mon premier manuscrit, Moi comme les chiens, quand j’avais 23 ans, c’était en 2006 et on m’a dit que c’était du polar qu’il fallait l’envoyer à des éditeurs de polars donc je l’ai fait mais moi je n’étais pas quelqu’un du tout qui avait une culture polar ou qui en lit.
BM : Moi comme les chiens, ça parlait de quoi ?
SDR: Moi comme les chiens, c’est une histoire de vengeance et une histoire d’amour entre deux hommes, c’est l’histoire d’une vengeance… je ne suis pas très douée pour présenter mes livres, je suis vraiment nulle pour ça, les quatrièmes de couv’ sont très bien faites… Rires
BM : Pour parler du second, Jaguars, pour moi c’est du roman noir parce que c’est écrit du côté des perdants, ou du côté des losers, écrire du roman noir c’est d’être de côté-là, de ce monde là…
SDR : Le monde que je décris c’est le monde de leur classe sociale, c’est peut-être une classe sociale de perdants, je ne sais pas. Quand je décris les jeunes qui sont à Rive-de-Gier, ce sont des jeunes qui rouillent en fait et qui se font chier… moi je n’ai pas vécu à Rive-de-Gier mais à Montbrison, j’ai pas mal traîné sur Saint-Étienne et ensuite à Villeurbanne et c’est comme ça qu’on traînait, on rouillait, on n’avait pas de boulot, on se faisait chier quoi. Donc c’est un peu la jeunesse que j’ai connue et que j’ai vécue.
BM : Quand je dis que ce sont des perdants c’est parce qu’on sent que tout ce que tentent les personnages, c’est compliqué, qu’ils vont souvent vers l’échec même si ce n’est pas volontaire.
SDR : Ouais, ça finit pas trop mal quand même pour eux… On utilisait pas mal le terme galère à l’époque quand on avait 16, 17 ans. C’est l’impression que finalement, il n’y a jamais rien qui s’améliore, on ne trouve pas de boulot, c’est une spirale, et après comme on est pauvres, on s’en sort mal, on ne rebondit pas, et les choses vont de pire en pire et c’est quelque chose que j’avais envie de traduire. C’est pas quelque chose que j’ai tant vécue personnellement parce que j’ai pas mal bougé, je suis allée au Canada, mais des amis semblaient dans cette spirale où on ne s’en sort pas donc le but est plus pour traduire un sentiment de galère.
BM : C’est comme le personnage de Sam, on sent qu’il a des projets, des choses lointaines…
SDR : Je voulais parler de l’engagement, enfin de ce que lui considère comme de l’engagement politique, je me suis pas mal intéressée à ça, et je me suis rendu compte qu’un jeune qui commence à acquérir ce qu’on pourrait appeler une conscience de classe, à tord ou à raison, la question n’est pas de dire si c’est bien de s’engager à l’extrême-gauche ou dans les mouvements communistes, je crois que ce jeune il n’y comprendrait rien, il n’y a plus aucune structure qui est là pour faire de l’éducation populaire et politique. Avant il y avait le PCF qui était immense, très fort avec des structures de formation qui étaient très efficaces, il y avait les FRANCAS, etc. et maintenant il n’y a plus rien de tout ça. On peut se dire que quelqu’un de ce milieu là qui n’a pas d’éducation et qui voudrait se consacrer à un mouvement comme ça, à la limite il pourrait même pas le faire parce que je ne vois pas comment il pourrait le comprendre. Mes amis ne comprennent pas du tout les livres de Marx, voir même ils s’en foutent mais même s’ils en feuillètent, ils n’y comprennent rien, ce n’est pas possible qu’ils le comprennent, c’est un peu ce que j’avais envie de dire…
BM : Ce qui est intéressant c’est que tous les personnages, que ce soit lui ou Godzilla, peuvent être naïfs à la fois touchant, puis violents, ça crée un rythme dans le livre, on ne sait jamais dans quel sens ça peut basculer, parfois on est surpris parce que c’est beaucoup plus sympa que ce qu’on pensait, parfois beaucoup plus violents… ça crée une structure, une tension…
SDR : C’est comme ça la vie, les gens sont comme ça… Les personnages sont comme ça parce que des fois, on peut décevoir à fond, et des fois il peut y avoir un geste vachement gentil de gens dont on n’attend pas ça.
BM : On pense au début que le personnage de Godzilla est juste une grosse brute mais il s’étoffe par rapport à ça au fur et à mesure. Vous parliez d’une histoire d’amour, et là c’est aussi une histoire d’amour avant tout ?
SDR : Euh ouais, plus que dans Moi comme les chiens. Je ne sais pas si histoire d’amour est approprié, certains disent que c’est une histoire d’amour donc je le réutilise, je ne sais pas si amour, c’est le bon terme. Je vois plus ça comme des gens qui sont très seuls et qui se rencontrent et finalement qui cherchaient à combler quelque chose, qui cherchaient à combler leur solitude, et en l’occurrence ce sont des gens qui couchent ensemble, je ne sais pas si j’utiliserais le terme amour pour qualifier la relation qu’ils ont. L’amour, c’est toujours l’alibi d’un crime, ça sert à cacher quelque chose qui est assez malsain enfin surtout dans la littérature, comme ces alliances de classe entre des personnages que tout oppose mais comme ils s’aiment, c’est possible, ce sont des gens qui sont très seuls et qui se rencontrent et qui font l’amour ensemble.
BM : Et qui ont besoin d’être dépendant l’un de l’autre, de créer une dépendance…
SDR : Voilà…
BM : Est-ce que vous vous êtes posée la question du côté trash ? Ça pourrait être trop ou pas assez, mais c’est entre les deux, ce qui m’a touché c’est que ce n’est jamais dans la provocation…
SDR: Je regrette ne pas me la poser plus cette question, parce que j’ai vraiment écris cette histoire sans me poser de question et je constate qu’il y a beaucoup de gens qui ne retiennent que ça, et ça me fait un peu chier parce que moi je n’écris pas des livres pour qu’après on se rappelle qu’un personnage a sodomisé un autre avec un gun, ou je ne sais pas ce qu’il y a dans l’autre, des scènes plus ou moins trashs alors que pour moi ce n’est pas ça le truc… alors j’aurais dû plus faire attention. Je regrette.
BM : Ce que je trouve intéressant, c’est que ça devient un décor normal, la question ne se pose plus tellement, ils vivent dans ce monde là, c’est leur univers et c’est tout…
SDR : Normalement, ça devrait être ça, mais beaucoup de lecteurs… après ce sont des gens qui n’ont pas l’habitude de lire ce genre de livres… Quand on me pose la question sur ce que j’écris, je dis que j’écris des livres pour adultes, des livres pour adultes qui ne concernent que les adultes, il ne faut pas lire ça si on veut lire des livres grands publics que les enfants peuvent lire, bon comme je suis en polar, il y a des gens qui voient ça sur la table des polars, il y a la pile Jaguars…
BM : A côté de Camilla Läckberg…
SDR : … et ce n’est pas un polar comme ça, c’est un livre qui est réservé aux adultes…
BM : Mais pour moi c’est ça le polar par rapport au roman policier qui est plus propre.
SDR : Tu vois, il y a des gens qui m’ont écrit, qui ont pris ce livre et qui me disent que ça avait l’air bien, qui ont lu le quatrième de couverture qui n’est pas très explicite, qui me demandent qu’est-ce que c’est que ce livre ? c’est de la pornographie ! c’est porno ! c’est ordurier ! comment on peut écrire ça ? Comment ça peut être publié, c’est une honte !… Moi je ne regrette un peu finalement de ne pas avoir réussi à faire quelque chose de plus universelle, ce qui est une qualité, de pouvoir écrire pour tout le monde. Du moment que tu fais quelque chose de sectaire, c’est dommage, j’aurais dû me poser plus la question.
BM : C’est marrant, parce que c’est un peu sex and drugs and rock’n'roll mais ce n’est pas plus trash que…
SDR : J’ai lu des trucs pires, quand on me dit que c’est dégueulasse, c’est porno, moi je dis vous avez lu Jean Genet…
BM : Ce que je trouve c’est que ce n’est pas provoquant, en tout cas pas volontairement…
SDR : Mais Jean Genet ce n’est pas volontairement provoquant non plus mais je trouve ça quand même plus trash que ce que j’écris de loin en matière érotique…
BM : Peut-être que les gens n’ont pas l’habitude de trucs érotiques entre deux mecs…
SDR : Ben oui et comme je suis une nana… je serais un mec, les gens se diraient que c’est un pédé qui écrit sur les pédés, là comme je suis une nana ils se disent mais pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle utilise des mots comme ça ? Il y a pas mal de mecs qui m’ont dit pourquoi utiliser des mots aussi moches quand on est une jeune femme, mignonne et tout, enfin voila.. après chacun a sa façon d’interpréter un livre, c’est une bouteille lancée à la mer…
BM : Au niveau de la forme on sent un travail sur la simplicité, sur la rapidité…
SDR : Les trucs compliqués ça me fait chier, c’est chiant, moi je vais au plus simple possible, je travaille pour que ce soit le plus simple avec des mots simples…
BM : J’ai l’impression qu’il y avait une volonté de faire quelques passages un peu longs et descriptifs où vous plantez le décor, après c’est bon, il n’y a plus besoin de le faire, on est dedans…
SDR : Peut-être que ça vient de la BD, je faisais de la BD en amateur, et le principe c’est quand tu commences une histoire, tu commences par le décor puis tu fais ton truc. J’avais le guide du mangaka de Akira Toriyama et il disait de commencer son histoire par une case où on voit le décor, c’est super important, et du coup ça a du me marquer au point de le mettre dans mes romans…
BM : Comme quand ils arrivent sur Paris, il y a une petite description, et après il n’y en a plus besoin…
SDR : C’est chiant aussi les descriptions…
BM : J’ai l’impression que les personnages sont plus décrits par les dialogues qu’ils ont que par une description d’eux, ce sont les dialogues qui leur donnent leur profondeur…
SDR : Oui, j’aime bien les dialogues en fait. J’aime bien, c’est un truc que je kiffe bien, que je sais bien faire alors…
BM : Quand vous écrivez, l’important c’est l’idée de rythme, ou l’ambiance… ?
SDR : Déjà écrire une histoire, c’est pas mal, alors le rythme, l’ambiance… j’écris une histoire, au début je ne l’ai pas vraiment, et puis ça vient petit à petit, des fois, ça foire, ça n’aboutit pas, alors j’abandonne le roman, je fais un autre truc. Mais une fois qu’elle est là, j’écris mon bordel, je suis contente parce que c’est chiant d’écrire il ne faut pas croire. Les gens s’imaginent que c’est super bien d’écrire mais on gagne rien, on ne gagne pas d’argent, ça prend toute la journée. Franchement n’écrivez pas, c’est relou, je le pense.
BM : Le fait de débuter chaque passage avec une phrase très anodine, très prosaïque… C’était une façon de mettre une certaine distance ?
SDR : J’avais commencé à faire ça avec Moi comme les chiens, et je ne sais pas, j’aime bien cette façon de faire. Comme ça quand je veux retrouver un chapitre, je sais où il est. Je sais que c’est la clé à molette, je ne sais pas pour Jaguars, il y a au cinoche, Paris ville de merde, ça vient peut-être des mangas quand j’en lisais avant, je ne sais pas ça vient peut-être de là… je ne sais pas, je m’en rappelle plus…
BM : Ça crée une certaine distance sans qu’il y ait de jugements…
SDR; T’as kiffé, t’as vraiment lu le livre… putain… Rires
BM : Ben je travaille…
SDR : C’est très bien mais tes questions sont bien compliquées… Rires. C’était quoi la question ?
BM : Ça crée une petite distance, une légère ironie mais sans jugement…
SDR : Moi je n’ai pas envie de juger mes trucs… le lecteur les juge tout seul. Ils sont assez grands, je n’ai pas envie de juger mes personnages, les gens sont assez grands et intelligents, c’est à eux de le faire, c’est aux lecteurs, ce n’est pas à moi.
BM : J’ai lu quelque part que c’était plus le cinéma que le roman qui vous influence.
SDR : C’était dans le sens où je ne lis pas de polar, ça me fait chier, les histoires avec des flics qui font des enquêtes… Du coup je vais plus connaître le polar par les films et encore, ce sont des films connus, Taxi Driver, ou le japonais Takeshi Miike que tout le monde connait… en plus je ne vais plus au cinéma donc je suis totalement en dehors du coup, mais je vais plus au cinéma dans le sens où je suis très contente que des gens lisent des polars mais moi ça ne m’intéresse pas plus que ça…
BM: Et la musique, le côté groupe punk, c’est un univers qui vous intéresse ?
SDR : C’est en fait que je trouve que les gens qui ont ce genre là mignons, mais sinon ça me fait chier, le rock, j’en ai marre, j’en ai écouté toute mon enfance. C’est juste que je les trouve mignons, j’aime bien les mecs dans des jeans slim, les cheveux longs, bien minces, je les trouve bien, c’est tout donc je les mets dans mes romans, je trouve ça marrant. Ils me font bien kiffer.
BM : Vous avez des projets de roman noir ?
SDR : Je suis en train de travailler sur un truc qui se passe pendant Thermidor à la révolution française, c’est une période qui m’intéresse, mais ça restera mon truc.
BM : Des punks pendant la révolution française…
SDR : Voilà…
Baptiste Madamour
Du noir dans les veines (.fr)
 « Gibert
Platier avait vu juste. Godzilla aussi. Ils étaient des amateurs. Ils
n’y connaissaient rien. Deux Al Capone clochardisés, en virée dans
l’underground lumpenprolétaire. Politiquement, ils étaient des bouffons.
« Gibert
Platier avait vu juste. Godzilla aussi. Ils étaient des amateurs. Ils
n’y connaissaient rien. Deux Al Capone clochardisés, en virée dans
l’underground lumpenprolétaire. Politiquement, ils étaient des bouffons.- J’ai juste sniffé. Une toute petite trace. C’est pas grave.
- Si c’est grave. Tu fais chier !
- Sam, je voulais tester sa dope. Pour voir s’il était aussi influent qu’il le prétend et…
- Ça me tue que tu fasses comme nos putain de vieux ! Ils t’ont pas servi d’exemple, merde ? »
Sophie Di Ricci, Jaguars.
Face à la mode de ces romans policiers à l’ancienne avec un flic, un crime horrible, une enquête et tout qui rentre dans l’ordre à la fin, les livres de Sophie Di Ricci font tâches, comme dans tout bon roman noir, elle écrit de l’autre côté de la matraque, avec une spontanéité que l’on retrouve dans cet entretien qui s’est déroulé aux journées Sang d’Encre de Vienne en novembre 2011.
Son dernier livre paru, Jaguars publié par les éditions Moisson Rouge, raconte l’histoire de deux frères déphasés, anciens membres d’un groupe punk et de leur rencontre avec un petit mafieux peut-être encore plus déjanté qu’eux.
BM : Comment êtes-vous arrivée au roman noir ?
Sophie Di Ricci : J’ai toujours écrit des trucs assez violents avec des meurtres et des beaux mecs, mais je ne savais pas que c’était du roman noir en fait. J’ai fini mon premier manuscrit, Moi comme les chiens, quand j’avais 23 ans, c’était en 2006 et on m’a dit que c’était du polar qu’il fallait l’envoyer à des éditeurs de polars donc je l’ai fait mais moi je n’étais pas quelqu’un du tout qui avait une culture polar ou qui en lit.
BM : Moi comme les chiens, ça parlait de quoi ?
SDR: Moi comme les chiens, c’est une histoire de vengeance et une histoire d’amour entre deux hommes, c’est l’histoire d’une vengeance… je ne suis pas très douée pour présenter mes livres, je suis vraiment nulle pour ça, les quatrièmes de couv’ sont très bien faites… Rires
BM : Pour parler du second, Jaguars, pour moi c’est du roman noir parce que c’est écrit du côté des perdants, ou du côté des losers, écrire du roman noir c’est d’être de côté-là, de ce monde là…
SDR : Le monde que je décris c’est le monde de leur classe sociale, c’est peut-être une classe sociale de perdants, je ne sais pas. Quand je décris les jeunes qui sont à Rive-de-Gier, ce sont des jeunes qui rouillent en fait et qui se font chier… moi je n’ai pas vécu à Rive-de-Gier mais à Montbrison, j’ai pas mal traîné sur Saint-Étienne et ensuite à Villeurbanne et c’est comme ça qu’on traînait, on rouillait, on n’avait pas de boulot, on se faisait chier quoi. Donc c’est un peu la jeunesse que j’ai connue et que j’ai vécue.
BM : Quand je dis que ce sont des perdants c’est parce qu’on sent que tout ce que tentent les personnages, c’est compliqué, qu’ils vont souvent vers l’échec même si ce n’est pas volontaire.
SDR : Ouais, ça finit pas trop mal quand même pour eux… On utilisait pas mal le terme galère à l’époque quand on avait 16, 17 ans. C’est l’impression que finalement, il n’y a jamais rien qui s’améliore, on ne trouve pas de boulot, c’est une spirale, et après comme on est pauvres, on s’en sort mal, on ne rebondit pas, et les choses vont de pire en pire et c’est quelque chose que j’avais envie de traduire. C’est pas quelque chose que j’ai tant vécue personnellement parce que j’ai pas mal bougé, je suis allée au Canada, mais des amis semblaient dans cette spirale où on ne s’en sort pas donc le but est plus pour traduire un sentiment de galère.
BM : C’est comme le personnage de Sam, on sent qu’il a des projets, des choses lointaines…
SDR : Je voulais parler de l’engagement, enfin de ce que lui considère comme de l’engagement politique, je me suis pas mal intéressée à ça, et je me suis rendu compte qu’un jeune qui commence à acquérir ce qu’on pourrait appeler une conscience de classe, à tord ou à raison, la question n’est pas de dire si c’est bien de s’engager à l’extrême-gauche ou dans les mouvements communistes, je crois que ce jeune il n’y comprendrait rien, il n’y a plus aucune structure qui est là pour faire de l’éducation populaire et politique. Avant il y avait le PCF qui était immense, très fort avec des structures de formation qui étaient très efficaces, il y avait les FRANCAS, etc. et maintenant il n’y a plus rien de tout ça. On peut se dire que quelqu’un de ce milieu là qui n’a pas d’éducation et qui voudrait se consacrer à un mouvement comme ça, à la limite il pourrait même pas le faire parce que je ne vois pas comment il pourrait le comprendre. Mes amis ne comprennent pas du tout les livres de Marx, voir même ils s’en foutent mais même s’ils en feuillètent, ils n’y comprennent rien, ce n’est pas possible qu’ils le comprennent, c’est un peu ce que j’avais envie de dire…
BM : Ce qui est intéressant c’est que tous les personnages, que ce soit lui ou Godzilla, peuvent être naïfs à la fois touchant, puis violents, ça crée un rythme dans le livre, on ne sait jamais dans quel sens ça peut basculer, parfois on est surpris parce que c’est beaucoup plus sympa que ce qu’on pensait, parfois beaucoup plus violents… ça crée une structure, une tension…
SDR : C’est comme ça la vie, les gens sont comme ça… Les personnages sont comme ça parce que des fois, on peut décevoir à fond, et des fois il peut y avoir un geste vachement gentil de gens dont on n’attend pas ça.
BM : On pense au début que le personnage de Godzilla est juste une grosse brute mais il s’étoffe par rapport à ça au fur et à mesure. Vous parliez d’une histoire d’amour, et là c’est aussi une histoire d’amour avant tout ?
SDR : Euh ouais, plus que dans Moi comme les chiens. Je ne sais pas si histoire d’amour est approprié, certains disent que c’est une histoire d’amour donc je le réutilise, je ne sais pas si amour, c’est le bon terme. Je vois plus ça comme des gens qui sont très seuls et qui se rencontrent et finalement qui cherchaient à combler quelque chose, qui cherchaient à combler leur solitude, et en l’occurrence ce sont des gens qui couchent ensemble, je ne sais pas si j’utiliserais le terme amour pour qualifier la relation qu’ils ont. L’amour, c’est toujours l’alibi d’un crime, ça sert à cacher quelque chose qui est assez malsain enfin surtout dans la littérature, comme ces alliances de classe entre des personnages que tout oppose mais comme ils s’aiment, c’est possible, ce sont des gens qui sont très seuls et qui se rencontrent et qui font l’amour ensemble.
BM : Et qui ont besoin d’être dépendant l’un de l’autre, de créer une dépendance…
SDR : Voilà…
BM : Est-ce que vous vous êtes posée la question du côté trash ? Ça pourrait être trop ou pas assez, mais c’est entre les deux, ce qui m’a touché c’est que ce n’est jamais dans la provocation…
SDR: Je regrette ne pas me la poser plus cette question, parce que j’ai vraiment écris cette histoire sans me poser de question et je constate qu’il y a beaucoup de gens qui ne retiennent que ça, et ça me fait un peu chier parce que moi je n’écris pas des livres pour qu’après on se rappelle qu’un personnage a sodomisé un autre avec un gun, ou je ne sais pas ce qu’il y a dans l’autre, des scènes plus ou moins trashs alors que pour moi ce n’est pas ça le truc… alors j’aurais dû plus faire attention. Je regrette.
BM : Ce que je trouve intéressant, c’est que ça devient un décor normal, la question ne se pose plus tellement, ils vivent dans ce monde là, c’est leur univers et c’est tout…
SDR : Normalement, ça devrait être ça, mais beaucoup de lecteurs… après ce sont des gens qui n’ont pas l’habitude de lire ce genre de livres… Quand on me pose la question sur ce que j’écris, je dis que j’écris des livres pour adultes, des livres pour adultes qui ne concernent que les adultes, il ne faut pas lire ça si on veut lire des livres grands publics que les enfants peuvent lire, bon comme je suis en polar, il y a des gens qui voient ça sur la table des polars, il y a la pile Jaguars…
BM : A côté de Camilla Läckberg…
SDR : … et ce n’est pas un polar comme ça, c’est un livre qui est réservé aux adultes…
BM : Mais pour moi c’est ça le polar par rapport au roman policier qui est plus propre.
SDR : Tu vois, il y a des gens qui m’ont écrit, qui ont pris ce livre et qui me disent que ça avait l’air bien, qui ont lu le quatrième de couverture qui n’est pas très explicite, qui me demandent qu’est-ce que c’est que ce livre ? c’est de la pornographie ! c’est porno ! c’est ordurier ! comment on peut écrire ça ? Comment ça peut être publié, c’est une honte !… Moi je ne regrette un peu finalement de ne pas avoir réussi à faire quelque chose de plus universelle, ce qui est une qualité, de pouvoir écrire pour tout le monde. Du moment que tu fais quelque chose de sectaire, c’est dommage, j’aurais dû me poser plus la question.
BM : C’est marrant, parce que c’est un peu sex and drugs and rock’n'roll mais ce n’est pas plus trash que…
SDR : J’ai lu des trucs pires, quand on me dit que c’est dégueulasse, c’est porno, moi je dis vous avez lu Jean Genet…
BM : Ce que je trouve c’est que ce n’est pas provoquant, en tout cas pas volontairement…
SDR : Mais Jean Genet ce n’est pas volontairement provoquant non plus mais je trouve ça quand même plus trash que ce que j’écris de loin en matière érotique…
BM : Peut-être que les gens n’ont pas l’habitude de trucs érotiques entre deux mecs…
SDR : Ben oui et comme je suis une nana… je serais un mec, les gens se diraient que c’est un pédé qui écrit sur les pédés, là comme je suis une nana ils se disent mais pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle utilise des mots comme ça ? Il y a pas mal de mecs qui m’ont dit pourquoi utiliser des mots aussi moches quand on est une jeune femme, mignonne et tout, enfin voila.. après chacun a sa façon d’interpréter un livre, c’est une bouteille lancée à la mer…
BM : Au niveau de la forme on sent un travail sur la simplicité, sur la rapidité…
SDR : Les trucs compliqués ça me fait chier, c’est chiant, moi je vais au plus simple possible, je travaille pour que ce soit le plus simple avec des mots simples…
BM : J’ai l’impression qu’il y avait une volonté de faire quelques passages un peu longs et descriptifs où vous plantez le décor, après c’est bon, il n’y a plus besoin de le faire, on est dedans…
SDR : Peut-être que ça vient de la BD, je faisais de la BD en amateur, et le principe c’est quand tu commences une histoire, tu commences par le décor puis tu fais ton truc. J’avais le guide du mangaka de Akira Toriyama et il disait de commencer son histoire par une case où on voit le décor, c’est super important, et du coup ça a du me marquer au point de le mettre dans mes romans…
BM : Comme quand ils arrivent sur Paris, il y a une petite description, et après il n’y en a plus besoin…
SDR : C’est chiant aussi les descriptions…
BM : J’ai l’impression que les personnages sont plus décrits par les dialogues qu’ils ont que par une description d’eux, ce sont les dialogues qui leur donnent leur profondeur…
SDR : Oui, j’aime bien les dialogues en fait. J’aime bien, c’est un truc que je kiffe bien, que je sais bien faire alors…
BM : Quand vous écrivez, l’important c’est l’idée de rythme, ou l’ambiance… ?
SDR : Déjà écrire une histoire, c’est pas mal, alors le rythme, l’ambiance… j’écris une histoire, au début je ne l’ai pas vraiment, et puis ça vient petit à petit, des fois, ça foire, ça n’aboutit pas, alors j’abandonne le roman, je fais un autre truc. Mais une fois qu’elle est là, j’écris mon bordel, je suis contente parce que c’est chiant d’écrire il ne faut pas croire. Les gens s’imaginent que c’est super bien d’écrire mais on gagne rien, on ne gagne pas d’argent, ça prend toute la journée. Franchement n’écrivez pas, c’est relou, je le pense.
BM : Le fait de débuter chaque passage avec une phrase très anodine, très prosaïque… C’était une façon de mettre une certaine distance ?
SDR : J’avais commencé à faire ça avec Moi comme les chiens, et je ne sais pas, j’aime bien cette façon de faire. Comme ça quand je veux retrouver un chapitre, je sais où il est. Je sais que c’est la clé à molette, je ne sais pas pour Jaguars, il y a au cinoche, Paris ville de merde, ça vient peut-être des mangas quand j’en lisais avant, je ne sais pas ça vient peut-être de là… je ne sais pas, je m’en rappelle plus…
BM : Ça crée une certaine distance sans qu’il y ait de jugements…
SDR; T’as kiffé, t’as vraiment lu le livre… putain… Rires
BM : Ben je travaille…
SDR : C’est très bien mais tes questions sont bien compliquées… Rires. C’était quoi la question ?
BM : Ça crée une petite distance, une légère ironie mais sans jugement…
SDR : Moi je n’ai pas envie de juger mes trucs… le lecteur les juge tout seul. Ils sont assez grands, je n’ai pas envie de juger mes personnages, les gens sont assez grands et intelligents, c’est à eux de le faire, c’est aux lecteurs, ce n’est pas à moi.
BM : J’ai lu quelque part que c’était plus le cinéma que le roman qui vous influence.
SDR : C’était dans le sens où je ne lis pas de polar, ça me fait chier, les histoires avec des flics qui font des enquêtes… Du coup je vais plus connaître le polar par les films et encore, ce sont des films connus, Taxi Driver, ou le japonais Takeshi Miike que tout le monde connait… en plus je ne vais plus au cinéma donc je suis totalement en dehors du coup, mais je vais plus au cinéma dans le sens où je suis très contente que des gens lisent des polars mais moi ça ne m’intéresse pas plus que ça…
BM: Et la musique, le côté groupe punk, c’est un univers qui vous intéresse ?
SDR : C’est en fait que je trouve que les gens qui ont ce genre là mignons, mais sinon ça me fait chier, le rock, j’en ai marre, j’en ai écouté toute mon enfance. C’est juste que je les trouve mignons, j’aime bien les mecs dans des jeans slim, les cheveux longs, bien minces, je les trouve bien, c’est tout donc je les mets dans mes romans, je trouve ça marrant. Ils me font bien kiffer.
BM : Vous avez des projets de roman noir ?
SDR : Je suis en train de travailler sur un truc qui se passe pendant Thermidor à la révolution française, c’est une période qui m’intéresse, mais ça restera mon truc.
BM : Des punks pendant la révolution française…
SDR : Voilà…
Baptiste Madamour
mardi 18 octobre 2011
Jaguars dans le Pandémonium littéraire
« Jaguars» de Sophie Di Ricci (Moisson Rouge)
Un roman très « sex, drugs and rock and roll » chez les truands par l’auteur d’un premier roman remarquable, « Moi comme les chiens » publié l’an dernier chez le même éditeur.
 Sam et Jon sont frères, n’ont pas encore trente ans et déjà leur passé derrière eux : ils formaient les Jaguars, groupe de punk hexagonal qui déchaîna les passions quelques années plus tôt avant que la drogue, le manque d’inspiration de l’un des deux et des incompatibilités d’humeurs avec la maison de disque ne fassent splitter le groupe. Entre squat, R.M.I., cure de désintox et retour chez leur mère ce n’est pas la joie pour les frangins… mais quand l’un se rêve en révolutionnaire armé à la Baader ou Carlos et que l’autre tape dans l’œil d’un drôle de bandit surnommé Godzilla, les choses peuvent basculer… et elles basculent !
Sam et Jon sont frères, n’ont pas encore trente ans et déjà leur passé derrière eux : ils formaient les Jaguars, groupe de punk hexagonal qui déchaîna les passions quelques années plus tôt avant que la drogue, le manque d’inspiration de l’un des deux et des incompatibilités d’humeurs avec la maison de disque ne fassent splitter le groupe. Entre squat, R.M.I., cure de désintox et retour chez leur mère ce n’est pas la joie pour les frangins… mais quand l’un se rêve en révolutionnaire armé à la Baader ou Carlos et que l’autre tape dans l’œil d’un drôle de bandit surnommé Godzilla, les choses peuvent basculer… et elles basculent !
Très beau roman sur le monde du rock et son miroir aux alouettes, la jeunesse paumée en province (Sam et Jon vivent à Rive-de-Gier, près de Saint Etienne) et le monde du grand banditisme (Godzilla pourrait sortir tout droit de la série Soprano). Un livre qui sonnent juste, notamment dans les dialogues, et qui respirent l’humanité, malgré la grande violence de certains passages et la fin tragique.
Chronique de Marianne Desroziers dans le Pandémonium littéraire
http://lepandemoniumlitteraire.blogspot.com/2011/10/jaguars-de-sophie-di-ricci-moisson.html
le blog de Jaguars : jaguarsdiricci.blospot.com
le blog de Jaguars : jaguarsdiricci.blospot.com
vendredi 9 septembre 2011
Mauvaise année pour Miki de José Ovejero chroniqué par Jean-Marc Laherrère
Suite de la rentrée littéraire avec un roman intéressant, même s’il n’a pas le même impact que le Stuart Neville. Il faut dire que le sujet s’y prête moins, beaucoup moins. Mauvaise année pour Miki de José Ovejero ou l’attraction du vide.
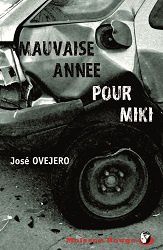
« 2001 fut une mauvaise année pour Miki ». Ainsi débute le roman, on ne peut mieux le résumer. Miki a une vie peut-être ennuyeuse mais rangée. Spécialiste économique il écrit dans des revues et intervient dans un programme radio une fois par semaine. En quelques semaines, son fils se tue en voiture d'une façon absurde et sa femme est violée et assassinée. Alors que la police patauge pour retrouver l'assassin, Miki continue ses activités comme si de rien n'était, s'isolant de plus en plus, passant son temps à jouer sur son ordinateur et à regarder des films pornos … S'enfonçant peu à peu dans la déprime, sans s'en rendre compte.
Etonnant roman, qui décrit le vide de certaines vies modernes de façon clinique. Miki ne réagit pas, ne fait rien, s'enferme de plus en plus chez lui refusant, au maximum, le contact avec les autres. Une réclusion aggravée par son métier qui consiste à étudier la bourse et conseiller des lecteurs ou des auditeurs. L'étude d'une entité désincarnée, sans autre réalité que les chiffres qu'elle brasse, au service de personnes que Miki ne voit jamais et sans jamais se poser de questions.
Une vie entière qui peut se mener seul, sans contact réel, sans contact avec le réel, et qui mène, sans recours, à la folie. Malgré ce vide, malgré le manque d'envie ou de sentiments de Miki, on suit sa déchéance sans ennui. C'est là le tour de force de ce roman étonnant.
José Ovejero / Mauvaise année pour Miki (Un mal año para Miki, 2003), Moisson rouge (2011), traduit de l’espagnol par Marianne Millon.
mardi 6 septembre 2011
MAUVAISE ANNEE POUR MIKI, de Jose OVEJERO
Sortie le 8 septembre
Chronique de Claude Le Nocher
http://action-suspense.over-blog.com/
 Publié en septembre 2011 aux Éditions Moisson Rouge, le roman de José Ovejero “Mauvaise année pour Miki” nous entraîne en Espagne. Miki est un expert financier âgé de 43 ans. Il vit à Madrid avec son épouse Verena et leur fils Boris, jeune adulte. N’ayant aucun souci d’argent, il se contente d’écrire des articles sur l’économie, et d’animer une émission de radio hebdomadaire. Chaque semaine, il prodigue analyses et conseils en placements. Par ailleurs, il ne quitte guère sa belle maison excentrée, en tête-à-tête avec son ordinateur. C’est un amateur de jeux vidéos et de sites pornos. Miki se sait peu attentif envers son épouse, et laisse une grande autonomie à son fils. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture à l’âge de sept ans, époque de ses tous premiers souvenirs. Miki assume son caractère introverti. S’il n’affiche jamais ses sentiments, il se montre fort convaincant dès qu’il s’agit de finances.
Publié en septembre 2011 aux Éditions Moisson Rouge, le roman de José Ovejero “Mauvaise année pour Miki” nous entraîne en Espagne. Miki est un expert financier âgé de 43 ans. Il vit à Madrid avec son épouse Verena et leur fils Boris, jeune adulte. N’ayant aucun souci d’argent, il se contente d’écrire des articles sur l’économie, et d’animer une émission de radio hebdomadaire. Chaque semaine, il prodigue analyses et conseils en placements. Par ailleurs, il ne quitte guère sa belle maison excentrée, en tête-à-tête avec son ordinateur. C’est un amateur de jeux vidéos et de sites pornos. Miki se sait peu attentif envers son épouse, et laisse une grande autonomie à son fils. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture à l’âge de sept ans, époque de ses tous premiers souvenirs. Miki assume son caractère introverti. S’il n’affiche jamais ses sentiments, il se montre fort convaincant dès qu’il s’agit de finances.
Chronique de Claude Le Nocher
http://action-suspense.over-blog.com/
 Publié en septembre 2011 aux Éditions Moisson Rouge, le roman de José Ovejero “Mauvaise année pour Miki” nous entraîne en Espagne. Miki est un expert financier âgé de 43 ans. Il vit à Madrid avec son épouse Verena et leur fils Boris, jeune adulte. N’ayant aucun souci d’argent, il se contente d’écrire des articles sur l’économie, et d’animer une émission de radio hebdomadaire. Chaque semaine, il prodigue analyses et conseils en placements. Par ailleurs, il ne quitte guère sa belle maison excentrée, en tête-à-tête avec son ordinateur. C’est un amateur de jeux vidéos et de sites pornos. Miki se sait peu attentif envers son épouse, et laisse une grande autonomie à son fils. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture à l’âge de sept ans, époque de ses tous premiers souvenirs. Miki assume son caractère introverti. S’il n’affiche jamais ses sentiments, il se montre fort convaincant dès qu’il s’agit de finances.
Publié en septembre 2011 aux Éditions Moisson Rouge, le roman de José Ovejero “Mauvaise année pour Miki” nous entraîne en Espagne. Miki est un expert financier âgé de 43 ans. Il vit à Madrid avec son épouse Verena et leur fils Boris, jeune adulte. N’ayant aucun souci d’argent, il se contente d’écrire des articles sur l’économie, et d’animer une émission de radio hebdomadaire. Chaque semaine, il prodigue analyses et conseils en placements. Par ailleurs, il ne quitte guère sa belle maison excentrée, en tête-à-tête avec son ordinateur. C’est un amateur de jeux vidéos et de sites pornos. Miki se sait peu attentif envers son épouse, et laisse une grande autonomie à son fils. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture à l’âge de sept ans, époque de ses tous premiers souvenirs. Miki assume son caractère introverti. S’il n’affiche jamais ses sentiments, il se montre fort convaincant dès qu’il s’agit de finances. Début 2001, son fils Boris est victime d’un mortel accident de voiture. Une mort atroce, alors que ses passagers sont saufs. Personne n’est capable d’élucider la cause du drame. L’alcool et la drogue prise la veille n’expliquent rien, d’autant que le jeune homme conduisait raisonnablement. Juste la fatalité. Quelques semaines plus tard, Verena est retrouvée morte dans un parc madrilène. Elle a été violée et assassinée sans témoin, bien qu’il s’agisse d’un lieu fréquenté. Ce second évènement ne semble pas ébranler Miki plus que la mort de son fils. Il ne tarde pas à reprendre son émission à la radio. S’il ne répond plus au téléphone et évite les achats à l’extérieur, il ne peut refuser une invitation de ses beaux-parents. Il n’a pas d’affinités, ni de peine, à partager avec eux.
Miki pourrait se laisser tenter par sa collègue de la radio, Lucía. Certes, ils ont une relation sexuelle, mais il conserve ses distances. Il est contacté par Mónica, la petite amie de Boris. Elle se trouvait avec lui et des amis dans la voiture, lors de l’accident. Miki trouve Mónica très excitante, mais la jeune fille ne semble pas chercher d’intimité avec le père de Boris. À la radio, Miki joue à l’économiste décomplexé, ce qui lui vaut une offre pour faire de la télé. Traînant dans le parc où Verena fut tuée, Miki est impliqué dans un incident à cause d’une prostituée. On lui parle d’un détective privé, qui n’a rien à voir avec l’image sombre de sa profession. Il serait plus efficace que la police pour découvrir l’assassin de Verena, mais Miki ne va pas donner pas suite. Bien que Lucía reste insistante, il espère encore que Mónica se laissera séduire…
Puisqu’il y est question d’un meurtre avec viol et d’un accident mal élucidé, on peut classer cette histoire parmi les romans criminels. Le meurtrier de Verena est identifié, et les conditions de la mort de Boris sont établies. Néanmoins, ce n’est pas ce qui importe en priorité. Tout repose sur le caractère de Miki. Car ce personnage évolue dans cette bulle d’insensibilité qu’il a créé, qui le protège des sentiments et de la vie extérieure. Ce qu’il exprime n’est pas une froideur, mais une perpétuelle distance envers tout le monde. Il avoue avoir, dans les semaines suivant le double drame, déjà occulté son épouse et son fils. Pour autant, il n’a rien de monstrueux, il n’est pas exempt de faiblesses, mais doit-on le trouver attachant ? Peu d’effets spectaculaires, mais une psychologie convaincante qui garantit une certaine originalité à ce roman. L’auteur nous propose un portrait subtil, nuancé, d’un héros glissant sur la pente de son égocentrisme.
mercredi 13 juillet 2011
La chronique de Clémentine Thiébaud, sur Noir comme Polar
Des trous dans le réel
08-07-2011
Federico Vite
Apportez-moi Octavio Paz

Nadia Polkon, une veuve diaphane. Rogelio, son fils. Retrouvé mort, un coup sévère porté à la tête. Parce que l'affaire captive, qu'il faut un coupable idéal, instantané, la mère est accusée d'infanticide avec la complicité du légiste. L'essentiel étant de donner une version plausible de l'assassinat. Le commandant Ojeda, lui, se dit qu'elle ferait une muse parfaite pour le roman qu'il voulait écrire depuis si longtemps. Inspiré par la femme, rasséréné par la maxime de Picasso - "un artiste emprunte, un génie plagie" - Ojeda entame son grand œuvre qui croit tel un "Frankenstein crée par un cordonnier", à grand renfort de phrases piochées dans les livres de sa bibliothèque. Avant de se demander à quoi pouvait bien rimer une histoire racontée par un "apprenti poète devenu commandant de police judiciaire". Il décide donc de s'offrir les services d'un professionnel. Ojeda fait kidnapper l'intouchable Octavio Paz, unique prix Nobel mexicain.
Chantages, compromissions, corruption, collusions, pannes, violences arbitraires, cynisme et désespoir débridés dans un court récit aux airs de conte noir, absurde et cinglant. La veuve d'Ocatvio Paz aurait d'ailleurs obtenu le retrait de la vente de tous les exemplaires du livre au Mexique, "considérant qu'il faisait du tort à son défunt* mari."
Clémentine Thiebault
* Nota Bene afin d'éclaircir un point (de détail certes) se rapportant à ce roman se jouant des frontières entre fiction et réalité (Paz a vraiment existé !), dans le but (louable) de ne pas en entraver la lecture, après celle de cette chronique : Le fait, avéré, qu'Octavio Paz soit décédé (et il n'y a pas que Wikipédia qui l'affirme) ne signifie pas nécessairement qu'Ojeda l'ai tué. Qu'on ne vous laisse pas craindre l'impair d'un critique indélicat qui vous dévoilerait la chute au détour négligé d'une phrase anodine, même si là n'est pas l'objet de ce récit mezcalien radicalement aux antipodes du whodunit. Il fallait que ce soit dit.
08-07-2011
Federico Vite
Apportez-moi Octavio Paz

Nadia Polkon, une veuve diaphane. Rogelio, son fils. Retrouvé mort, un coup sévère porté à la tête. Parce que l'affaire captive, qu'il faut un coupable idéal, instantané, la mère est accusée d'infanticide avec la complicité du légiste. L'essentiel étant de donner une version plausible de l'assassinat. Le commandant Ojeda, lui, se dit qu'elle ferait une muse parfaite pour le roman qu'il voulait écrire depuis si longtemps. Inspiré par la femme, rasséréné par la maxime de Picasso - "un artiste emprunte, un génie plagie" - Ojeda entame son grand œuvre qui croit tel un "Frankenstein crée par un cordonnier", à grand renfort de phrases piochées dans les livres de sa bibliothèque. Avant de se demander à quoi pouvait bien rimer une histoire racontée par un "apprenti poète devenu commandant de police judiciaire". Il décide donc de s'offrir les services d'un professionnel. Ojeda fait kidnapper l'intouchable Octavio Paz, unique prix Nobel mexicain.
Chantages, compromissions, corruption, collusions, pannes, violences arbitraires, cynisme et désespoir débridés dans un court récit aux airs de conte noir, absurde et cinglant. La veuve d'Ocatvio Paz aurait d'ailleurs obtenu le retrait de la vente de tous les exemplaires du livre au Mexique, "considérant qu'il faisait du tort à son défunt* mari."
Clémentine Thiebault
* Nota Bene afin d'éclaircir un point (de détail certes) se rapportant à ce roman se jouant des frontières entre fiction et réalité (Paz a vraiment existé !), dans le but (louable) de ne pas en entraver la lecture, après celle de cette chronique : Le fait, avéré, qu'Octavio Paz soit décédé (et il n'y a pas que Wikipédia qui l'affirme) ne signifie pas nécessairement qu'Ojeda l'ai tué. Qu'on ne vous laisse pas craindre l'impair d'un critique indélicat qui vous dévoilerait la chute au détour négligé d'une phrase anodine, même si là n'est pas l'objet de ce récit mezcalien radicalement aux antipodes du whodunit. Il fallait que ce soit dit.
mercredi 29 juin 2011
Apportez-moi Octavio Paz ; extrait
Le commandant Ojeda consulta sa montre. Il sortit de la cuisine avec précipitation, une tasse de café à la main. Il s’arrêta devant le téléviseur et l’alluma avec la télécommande.
Le commandant regardait un journal consacré aux faits-divers sanglants.
De fait, il apparut à l’écran. Il semblait plus maigre, ce qui n’était pas pour lui déplaire. Il prêta attention aux présentateurs du programme.
« L’homme à l’écran est le commandant Ojeda et il ne sait rien de rien. Regardez comme il fait souffrir cette femme », croassa le présentateur.
Une fragilité contagieuse naquît à l’écran, des sanglots de femme.
En voyant Nadia, le commandant Ojeda sentit qu’elle serait la muse parfaite pour le roman qu’il souhaitait écrire ; puis, dans un élan créatif, il éteignit le poste. Dans l’obscurité de la pièce, les yeux ouverts, il décida que l’affaire Polkon serait le sujet de son livre. Quelques secondes plus tard, il saisit son quarante-cinq millimètres sur la table basse.
Une détonation retentit, une balle transperça la chaussure du commandant.
vendredi 24 juin 2011
Extrait : Apportez-moi Octavio Paz ; Federico Vite
Les photographes se disputaient l’expression la plus sadique du visage d’un homme grand et chétif, dans l’espoir de prendre une série de grimaces diaboliques.
Varguitas, le médecin devenu meurtrier, se mit à pencher la tête et à émettre des petits bruits d’autant plus inaudibles que le commandant Rodríguez se servait du micro pour magnifier la conférence et intensifier sa voix de solennel serviteur public responsable, mais il eut rapidement l’air de commenter un défilé de mode, car de temps à autre, il efféminait son discours et insistait sur la qualité morale de l’individu et son accoutrement.
Les reporters se contentaient d’injurier Varguitas d’un qualificatif peu journalistique : couille molle. Lorsqu’ils présentèrent Nadia le silence fut profond, comme extrait d’une veillée funèbre, elle apparut sans défense et vaguement détachée d’elle-même, elle mentionnait avec euphorie qu’elle était prête à expier sa faute, ce qui contrastait totalement avec les premières versions de la suspecte. Un des chroniqueurs se chargea de lui demander comment elle cachait si bien les pensées perverses qu’elle renfermait ?
Les questions s’accumulèrent devant le visage de madame Polkon tandis que le commandant Rodríguez regardait avec stupeur la prévenue présenter une figure béate. Une douceur inhabituelle sortit de la bouche de l’accusée, des phrases isolées qui gagnèrent en cohérence à mesure qu’augmentait le volume de son laïus :
— Hier, un esprit est venu me dire que notre fils était condamné à vivre entre la vie et la mort parce qu’il s’était suicidé.
mercredi 15 juin 2011
Insa Sane au festival Etonnants Voyageurs
Insa Sane déclamant les premières pages de son livre lors d'un café littéraire avec Oxmo Puccino et Rachid Santaki au festival Etonnants Voyageurs.
vendredi 10 juin 2011
"Apportez-moi Octavio Paz" de Federico Vite
Le commandant Ojeda rêve depuis tout jeune de devenir un grand écrivain. L'affaire Polkon tombe à pic, cela ferait un merveilleux sujet pour son premier livre.
La veuve Polkon est accusée du meurtre de son fils Rogelio, dont l'esprit continue de la hanter, et elle retrouve en prison le goût de l'orgasme et son teint de jeune fille.
En mal d'inspiration, le commandant Ojeda fait kidnapper le poète Octavio Paz pour l'aider sur son manuscrit, mais le prix Nobel ne compte pas se laisser faire. Et s'il voyait là l'occasion de signer enfin son premier roman.
Du chantage littéraire, des policiers fainéants et corrompus, une justice expéditive et des voitures qu tombent systématiquement en panne... Federico Vite signe ici une novela délirante, un conte absurde sur la société mexicaine et le monde littéraire où se mêlent délicieusement ironie et humour noir.
La veuve d'Octavio Paz a obtenu le retrait des livres à la vente au Mexique.
SORTIE LE 23 JUIN 2011
La veuve Polkon est accusée du meurtre de son fils Rogelio, dont l'esprit continue de la hanter, et elle retrouve en prison le goût de l'orgasme et son teint de jeune fille.
En mal d'inspiration, le commandant Ojeda fait kidnapper le poète Octavio Paz pour l'aider sur son manuscrit, mais le prix Nobel ne compte pas se laisser faire. Et s'il voyait là l'occasion de signer enfin son premier roman.
Du chantage littéraire, des policiers fainéants et corrompus, une justice expéditive et des voitures qu tombent systématiquement en panne... Federico Vite signe ici une novela délirante, un conte absurde sur la société mexicaine et le monde littéraire où se mêlent délicieusement ironie et humour noir.
La veuve d'Octavio Paz a obtenu le retrait des livres à la vente au Mexique.
SORTIE LE 23 JUIN 2011
mardi 31 mai 2011
VIVA LA SEMANA NEGRA DE GIJON !
Vous ne connaissez peut-être par ce festival consacré aux mauvais genres, qui se déroule chaque été à Gijon dans les Asturies -Bretagne espagnole- et dure environ dix jours. Fusion réussie entre le festival littéraire et la fête populaire (concerts, grande roue, stands forains), cette petite perle noire créée par PACO TAIBO II rassemble la crème des écrivains sud américains et hispanophones. Malheureusement, entre les récentes élections, qui ont fait basculer l'Espagne à droite, le procès qu'intente le Recteur de l'université (pour que le festival ait lieu dans l'enceinte de l'université), et les graves difficultés budgétaires que rencontre l'organisation, le futur de notre Semaine Noire est sérieusement compromis. Les amoureux de cet évènement hors du commun lancent un appel à l'aide via notamment le groupe facebook Continuidad de la Semana Negra. Par les biais des blogs, sites, pages fb, articles de journaux et tout autre média, manifestez votre attachement pour la Semana Negra de Gijon, pour qu'elle reste cette rencontre privilégiée, cet exemple de ce que doit être un festival littéraire populaire.
“La littérature doit être dans la rue, sinon, elle est condamnée à mourir. Avec la Semana Negra, nous avons réussi à créer la République démocratique des lecteurs de Gijón car nous sommes des fabricants de rêves et d'utopies.” Paco Ignacio Taïb II
“La littérature doit être dans la rue, sinon, elle est condamnée à mourir. Avec la Semana Negra, nous avons réussi à créer la République démocratique des lecteurs de Gijón car nous sommes des fabricants de rêves et d'utopies.” Paco Ignacio Taïb II
Indices :
festival,
fête populaire,
mauvais genres,
roman noir,
Semana Negra
Noir comme polar chronique Psychose
Un vendredi après-midi à Phœnix, Arizona. Le patron de Mary Crane la charge de déposer à la banque les 40 000 dollars en cash qu'un négociant plein d'argent des concessions pétrolières vient de lui remettre pour l'achat d'une maison. Sur un coup de tête Mary décide de fuir avec l'argent, rejoindre l'homme qu'elle aime, Sam Loomis, un quincaillier d'une petite ville du Nord couvert de dettes qui les empêchent d'envisager le mariage. Mais après 18 heures de conduite, épuisée, égarée sur une route secondaire, Mary décide de s'arrêter pour la nuit. L'obscurité, la pluie et le vent la poussent au Bates Motel, étrange établissement vide, tenu par Norman Bates, gros homme pathétique qui vit seul avec sa mère, malade et tyrannique.
Réédition -augmentée d'une préface de Stéphane Bourgoin et d'un entretien inédit avec l'auteur- dans une nouvelle traduction d'un classique de l'horreur que Robert Bloch écrit en 1957, inspiré par l'histoire du boucher de Plainfield. Une mécanique de l'angoisse et de la folie intacte, aux échos évidemment amplifiés par les images indélébiles de l'adaptation géniale d'Alfred Hitchcock (1960). Il est d'ailleurs étonnant de constater à la (re)lecture à quel point les deux se nourrissent. L'atmosphère du livre fait surgir la silhouette angoissante de la vieille qui se découpe à la fenêtre de sa chambre, retentir le cri de Janet Leigh dans l'incontournable scène de la douche et rappelle qu'Anthony Perkins sera toujours Norman Bates, père des serial killer du polar américain, ou l'inverse. La tension schizophrénique latente qui explose en pics de violence, les dialogues, la nuit, le marais, l'ombre glaçante de la grande maison en surplomb et l'isolement nourrissent un récit dont le climat suffocant maintient à lui seul l'intérêt (rare) d'un livre à chute dont on connaît pourtant la fin.
Clémentine Thiebault
jeudi 19 mai 2011
Du noir dans les veines
Nous nous permettons de reproduire cet article que vous pouvez trouver sur le jeune blog polar de Baptiste Madamour, qui apparemment, a très bon gout.
Par Baptiste Madamour
"Le livre est découpé en plusieurs nouvelles dont une qui a la taille d’un court roman. Nous sommes plongés dans une cité russe à l’époque de la Perestroïka, des adolescents s’emmerdent, boivent se battent, s’humilient pour tuer le temps. Il ne se passe pas grand chose mais la tension est permanente, la violence peut surgir à tout moment.
L’écriture de Kovlov est puissante, sèche, le mot est toujours juste, l’auteur ne surplombe pas ce qu’il décrit, il montre ce qui est sans jugement, sans moral, il travaille sur la simplicité, la répétition des mots, des situations. Les phrases sont courtes, privilégient l’action même si on baigne dans l’inaction, faisant sentir une impression de mouvement inutile, de personnes coincées, ne pouvant s’extraire de leur environnement, du manque de futur. Le ton est agressif, dur, les dialogues sont très courts, impersonnels, le vocabulaire pauvre, cru et limité et pourtant grâce au style de l’auteur les textes ont une sombre beauté.
«On boit. Ça me tape sur la tête comme il faut. Je ferme les yeux et je comate aussi sec, je sais pas pendant combien de temps. Quand je me réveille, Orang-outang est en train de sauter Anokhina sur le divan et elle sourit la figure barbouillée de rouge à lèvres. Je repars dans le potage.
La deuxième fois, je suis réveillé par des cris. Tsigane tabasse Anokhina en gueulant :
- Tu m’as mordu la queue, salope. »
Un univers où les règles de vie sont apprises à coup de poing, à coup de pied des plus grands aux plus jeunes de façon immuable, le monde extérieur n’existe pas, les profs sont des ennemis, les filles des objets qu’on peut prendre, violenter, les parents sont des obstacles, des censeurs ou des pauvres types à mépriser. Ça se passe en Urss à une période précise, mais à quelques détails près ça pourrait se passer dans n’importe lequel de ces endroits tristes et vides où la misère sociale et affective empêche toute tendresse. Un livre très fort qui au final laisse la tristesse prendre le pas sur le dégoût. "
Baptiste Madamour
http://dunoirdanslesveines.fr/
mercredi 18 mai 2011
Art de Lire chronique Psychose
C'est bien évidemment le roman à l'origine du chef d’œuvre de Alfred Hitchcock. J'ai lu ce roman il y a plusieurs années et il m'a vraiment marqué! Au point que je n'ai vu le film que très récemment. De peur d'être déçu.
La psychologie des personnages m'avait prouvé à l'époque que rien n'est simple, et que la lecture demande une certaine attention!!! Et il est encore aujourd'hui pour moi un mètre-étalon dans son domaine!
mardi 17 mai 2011
Guillaume Fortin chronique Psychose de Robert Bloch
La publication, en 1959, du roman de Robert Bloch, Psychose (et de manière plus décisive encore, la sortie en salle, un an plus tard, de son adaptation cinématographie signée Alfred Hitchcock), marque l’avènement d’un nouveau genre : le thriller psychologique. Aux éléments d’ambiance et aux ressorts narratifs hérités du roman noir et du récit à énigme, ce spécimen parfait du genre, ajoute une innovation qui en constitue la caractéristique spécifique : impliquer le point de vue subjectif du lecteur dans la progression de l’intrigue.
Le suspens n’est plus seulement produit par l’analyse des indices permettant de découvrir les auteurs d’une suite d’évènements ayant rompu la continuité normée du quotidien (un meurtre ou un délit quelconque). Il est sous-tendu par une nouvelle logique qui place le lecteur (et non plus l’enquêteur-protagoniste) au centre des évènements qui se déroulent sous ses yeux.
Le lecteur « a vu » (presque tout vu) ce qui s’est passé. Il sait, ou, plus précisément, il en sait plus que les personnages de l’histoire eux-mêmes (enquêteurs compris). Il est toujours un peu en avance, sans que personne ne lui donne directement l’occasion d’expliquer les choses. Le lecteur est devenu le sujet du point de vue donné sur les évènements.
À la manière de L’homme qui en savait trop, il sait plus de choses que ce qu’il devrait. De ce fait, sa subjectivité est activée et stimulée de façon inédite. Non plus seulement par le biais de la déduction, mais par celui, plus direct, de l’affect – le frisson d’un voyeur à la fois sujet et objet de l’action qu’il contemple (la scène de la douche, la schizophrénie de Norman Bates).
Construit comme un scénario (après avoir beaucoup influencé le cinéma, la littérature américaine récolte à son tour les fruits des possibilités offertes par le 7ème art), le lecteur suit les différents points de vue d’un même évènement d’après les vécus des différents protagonistes qui en savent donc moins que le lui – ce dernier ayant déjà vu les choses se dérouler sous un autre angle.
Le lecteur est devenu sujet-voyeur, tout à la fois actif (sa subjectivité est activée par le fait qu’il sait ce que les protagonistes de l’action en cours ne savent pas encore) et terriblement impuissant (car tout est joué d’avance). D’où l’apparition d’un sentiment inédit (qui fit fureur, et fonctionne encore à merveille aujourd’hui), sentiment mêlé de tension et de douce terreur.
Psychose est aussi une histoire d’argent, et donc de culpabilité – et donc, de sexe (l’adaptation cinématographique exploitera d’avantage encore cette thématique en lui accordant une place prépondérante dès le début de l’intrigue et tout au long de la première partie du film suivant la mise en scène hyper-rythmée et à double niveau de lecture du réalisateur de génie – bien servie par une tout aussi génialissime bande originale d’un Bernard Herrmann au sommet de sa forme). Quelqu’un a bien commis une faute (l’argent dérobé qui mènera Mary au motel) et sera puni pour cet acte répréhensible. Punition morale, et immorale (en forme d’ironie du sort). D’ailleurs, l’argent sera finalement retrouvé : immaculé (« On découvrit l’argent dans la boîte à gants. Bizarrement, il n’y avait pas une goutte de boue dessus, pas une seule. »). La faute incomberait alors à autre chose que le vol : la présence d’une charge érotique tout à la fois implicite et refoulée (la scène de la douche dans sa version hitchcockienne).
Psychose est enfin une histoire de mère. Mère autoritaire, acariâtre et encombrante, figure castratrice à l’origine du pathos et de l’appréhension du sexe comme objet du refoulement (et déclencheur du retour du refoulé : le meurtre dans la douche).
Autant d’éléments (suspens psychologique, histoire de culpabilité, de sexe refoulé et de figure maternelle terrifiante) dont on comprendra qu’ils aient pu inspirer un cinéaste, et qui plus est un Hitchcock, dont l’adaptation du roman a marqué les esprits à tel point, que son film, devenu culte, a pris valeur de mythe inaugural (d’un genre dont le cinéaste fut et reste encore aujourd’hui le maître incontestable).
Dans ces conditions, lire ou relire le roman de Robert Bloch, donne l’agréable et troublante sensation de (re)plonger dans la mémoire matricielle d’une œuvre fascinante ayant contribué à inaugurer une nouvelle manière de raconter des histoires. Un pur chef-d’œuvre, réédité pour notre plus grand plaisir.
Nouvelle traduction d'Emmanuelle Pailler
Préface de Stéphane Bourgoin
mardi 22 mars 2011
Mémoires d’un poisson rouge ( PSAUME V)
Des allumés, il y en a un bon paquet, chez 10/18, particulièrement dans la collection « Domaine étranger », mais des fous furieux comme Joey Goebel, j’en avais pas encore rencontré jusqu’à présent. (Faut dire qu’avec un nom pareil…)
Prenez un état-uni comme le Kentucky, et réunissez-y cinq déjantés, authentiques inadaptés de toutes catégories, et vous obtiendrez THE ANOMALIES, un groupe de rock en devenir des plus réjouissants. Une punkette octogénaire et nymphomane à la guitare, une furie surdouée de huit ans à la basse, un immigré irakien en quête de rédemption (que tout le monde croit gay) aux claviers, et une beauté gothique frigide à la batterie… Le tout emmené par le chanteur, leader du groupe et auteur des textes, Luster, un black charismatique au look de timbré, doté d’une intelligence supérieure et d’une ironie à l’avenant.
La narration est particulièrement étonnante : comme une suite de témoignages recueillis sur le vif, la plupart de la bouche des principaux protagonistes, mais aussi, plus rarement, de celle des personnages secondaires. Ainsi, l’auteur s’efface totalement derrière ses créatures, évitant au maximum les descriptions et les dialogues, rendant au lecteur — ravi de ne pas être pris pour un con — la liberté de laisser courir son imagination.
Je ne dévoilerai en rien la trame ni l’histoire de ce roman presque trop beau pour être vrai. Car au delà de l’humour patent et de l’ironie mordante des situations drôlatiques, ce livre possède une dimension sincère et profonde : chronique tragi-comique de l’éternelle histoire des cinglés en tous genres. Bien plus, donc, qu’une simple pochade.
The anomalies est le premier roman de Joey Goebel, publié aux U.S.A. en 2003 et en français en 2009. Il est suivi en 2004 par Torturez l’artiste : Le grand patron d’une major de l’industrie du spectacle, atteint d’un cancer, réalise que toute sa vie, il n’a produit que de la merde. Au moment de lâcher la rampe, il cherche à se racheter en tentant de donner à voir et à entendre au grand public, des œuvres de qualité…
Féru de culture italienne, il crée alors dans le plus grand secret “Nouvelle Renaissance”, sorte d’école d’élite pour génies précoces, recrutés dès l’enfance aux quatre coins de la planète. Les élèves, destinés à devenir l’élite artistique de demain seront petit à petit introduits dans le milieu du show-bizness, provoquant une révolution qualitative depuis l’intérieur. Chacun des “protégés” se verra encadré par un agent aux méthodes quelque peu radicales… En effet, ces mentors seront officiellement chargés de torturer moralement leurs poulains — à l’insu de ces derniers — afin de stimuler leur créativité.
Ainsi, le narrateur, coach d’un tout jeune écrivain, songwriter et scénariste des plus prometteurs, sera amené pendant près de vingt ans à tuer son chien, faire foirer ses histoires d’amour, brûler sa maison et le rendre alcoolique — bref, à lui pourrir secrètement l’existence, tout en se faisant passer pour son meilleur ami et conseiller.
Né en 1980, ancien chanteur et guitariste Punk, ex rock critique, usant de la caricature à outrance, Joey Goebel — de son nom complet Adam Joseph Goebel III (y’a des parents qui méritent des baffes) — nous renvoie mine de rien dans nos buts. Sensible, drôle et purement rock’n roll, c’est un de ces rares (trop rares) auteurs qu’on peut reprendre au début dès la fin de la première lecture.
On attend maintenant Hartland, son troisième roman, à paraître chez Héloïse d’Ormesson.
Bonne lecture, bande de petits veinards !
jeudi 3 mars 2011
LECTURES ÉCOLOS.
par JC Ditroy
Il y a des contrevérités qui ont le don de me foutre hors de moi : prétendre qu'une voiture électrique est "propre", que l'énergie nucléaire est "non polluante" (comme si on avait résolu la question ô combien épineuse des déchets !) et qu'elle assure notre indépendance énergétique (ah bon ? on a de l'uranium, en France ?), ou bien encore, entendre déclarer sans rire que compacter les bouteilles en plastique vides, ça fait moins de déchets... (dixit Jérôme Bonaldi).
Alors quand on a la fibre écologiste, on peut toujours se donner bonne conscience et la gerbe en regardant Le cauchemar de Darwin d'Hubert Sauper, les putasseries du Hulot que je n’appelerai jamais Monsieur, et les insipides leçons de morale de l’homme à l’hélicoptère qui ne pollue pas, ou encore Une vérité qui dérange du regrettable Al Gore, dont la défaite ― par lui bien vite acceptée ― aux élections de 2000 (c’est à dire hier matin) , contre Dobeuliou Bush s'est jouée en Floride, l'un des écosystèmes le plus fragiles et les plus dévastés du monde, livré aux bétonneurs et aux pétroliers.
Mieux vaut nous plonger avec délice dans la lecture du très réjouissant Jackpot de Carl Hiaasen (10/18), auteur fendard, écolo, amoureux de sa Floride, justement, qui met en scène la confrontation entre une aide vétérinaire noire, éprise de nature et deux pécores néo-nazis, sous l'œil désabusé d'un journaliste bien évidemment alcoolique : un régal ! Du même auteur, Pêche en eaux troubles (toujours chez 10/18) décrit avec férocité les magouilles politico financières et les ravages combinés de la pêche « sportive » et du tourisme industrialisé. De quoi rigoler un bon coup (d’autant qu’il en a écrit plein d’autres, mais ces deux-là, c’est mes préférés...).
Un autre grand allumé, écrivain icône des années soixante, Edward Abbey, était un radical : saboteur de bulldozers et inspirateur du mouvement « Earth First! », qui rêvait de faire sauter les barrages et de rendre la nature à elle même. On lui doit une vingtaine de bouquins, dont le génial Gang de la clef à molette et sa suite, Le retour du gang de la clé à molette, réédités chez Gallmeister. Attentats jouissifs perpétrés par une bande de militants écolos complètement déjantés, livrant une guérilla sans merci à des industriels mormons dingues de pognon et d’uranium (c’est la même chose), dans le sublime décor de la région des four corners, ce désert à cheval sur les frontières de l'Utah, de l'Arizona, du Colorado et du Nouveau-Mexique.
À sa mort, en 1989, Edward Abbey fut enterré en secret , personne ne sait où exactement, dans ce désert qu'il aimait passionnément.
Alors ne boudez pas votre plaisir, pour une fois qu'on peut être écolo sans être ennuyeux...
JCD
Indices :
Carl Hiaasen,
écologie,
Edward Abbey,
JC Ditroy,
Lecture
mercredi 23 février 2011
Dépêche AFP : grand merci à Caroline TAIX
Rachid Santaki n'a pas honte de dire qu'il est un "symbole de l'échec scolaire" car ce battant a eu sa "revanche": son polar, "Les anges s'habillent en caillera", qui plonge le lecteur au coeur de Saint-Denis, s'arrache en librairie, surtout dans les quartiers populaires.
A la lecture du livre, on imagine un jeune auteur au style "caillera". Il écrit avec des mots de la cité et du dialecte marocain, à côté d'une langue plus classique. Il se place dans les quartiers populaires de Saint-Denis pour raconter l'histoire d'Ilyès, un voleur aguerri de cartes bancaires, que l'on voit "gravir les échelons de la délinquance", en quête d'argent facile.
Mais Rachid Santaki semble bien loin d'Ilyès, qui existe réellement et est actuellement incarcéré à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Il l'a rencontré plusieurs fois.
Si l'auteur, qui en est à son deuxième livre, reconnaît avoir fait "quelques conneries de gamin", c'est aujourd'hui un père de famille de 37 ans, avec "une tête de premier de la classe", parfois pris pour un policier par les jeunes de cité.
Lui qui a grandi à Saint-Ouen avant d'arriver à Saint-Denis, où il a "adopté la mentalité de cité", se décrit comme un "symbole de l'échec scolaire" avec sa 4e techno et son BEP compta. Mais il se veut surtout un "bosseur" et un "battant".
"Mon père a fait de moi un Rachid Balboa", dit-il, en référence à Rocky Balboa, le personnage incarné par Stallone au cinéma. Il raconte son "envie de prendre une revanche, de faire plein de choses".
Depuis l'adolescence, il passe du temps sur les rings de boxe à Saint-Denis, où il puise encore son inspiration. Et il n'a jamais arrêté de travailler: chauffeur livreur, manutentionnaire, éducateur sportif, il a créé le site internet hiphop.fr, puis le magazine 5Styles pour lequel il a obtenu de la chambre de commerce et d'industrie de Paris le prix Espoir de l'économie 2006.
"J'ai beaucoup observé les parcours autour de moi. Certains sont passés de l'autre côté, sont partis en prison et sont revenus changés, ça ne donnait pas envie", se rappelle-t-il.
Il déborde d'énergie et de créativité. Pour la promotion des "Anges s'habillent en caillera", il a passé des nuits à coller 3.000 affiches dans toute la Seine-Saint-Denis. Il court à la rencontre des lecteurs. Prochainement, il va tourner dans le 9-3 dans un van habillé aux couleurs du livre.
Il ne cache pas sa fierté face au succès de son polar. Les 2.000 premiers exemplaires ont été écoulés en quelques jours après sa sortie en janvier. Il y a eu une réédition à 2.000, et il va y en avoir encore une autre, se félicite son éditeur, "Moisson rouge".
Rachid Santaki montre des messages reçus sur Facebook de jeunes qui ne lisent pas d'habitude et qui n'ont pu lâcher son livre. "Ils se reconnaissent dans le langage, dans les personnages, dans les histoires", dit-il. "C'est pour ça qu'avec + Les anges +, le 93 a son premier roman noir", ajoute l'auteur.
"Dans mon entourage, certains étaient choqués que j'écrive un livre aussi sombre alors que je suis très positif", confie-t-il.
"J'avais envie de montrer que moi sorti de nulle part, j'étais capable de faire une fiction originale", explique Rachid Santaki, qui voudrait rencontrer des auteurs reconnus comme Dominique Manotti ou Didier Daeninckx.
A la lecture du livre, on imagine un jeune auteur au style "caillera". Il écrit avec des mots de la cité et du dialecte marocain, à côté d'une langue plus classique. Il se place dans les quartiers populaires de Saint-Denis pour raconter l'histoire d'Ilyès, un voleur aguerri de cartes bancaires, que l'on voit "gravir les échelons de la délinquance", en quête d'argent facile.
Mais Rachid Santaki semble bien loin d'Ilyès, qui existe réellement et est actuellement incarcéré à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Il l'a rencontré plusieurs fois.
Si l'auteur, qui en est à son deuxième livre, reconnaît avoir fait "quelques conneries de gamin", c'est aujourd'hui un père de famille de 37 ans, avec "une tête de premier de la classe", parfois pris pour un policier par les jeunes de cité.
Lui qui a grandi à Saint-Ouen avant d'arriver à Saint-Denis, où il a "adopté la mentalité de cité", se décrit comme un "symbole de l'échec scolaire" avec sa 4e techno et son BEP compta. Mais il se veut surtout un "bosseur" et un "battant".
"Mon père a fait de moi un Rachid Balboa", dit-il, en référence à Rocky Balboa, le personnage incarné par Stallone au cinéma. Il raconte son "envie de prendre une revanche, de faire plein de choses".
Depuis l'adolescence, il passe du temps sur les rings de boxe à Saint-Denis, où il puise encore son inspiration. Et il n'a jamais arrêté de travailler: chauffeur livreur, manutentionnaire, éducateur sportif, il a créé le site internet hiphop.fr, puis le magazine 5Styles pour lequel il a obtenu de la chambre de commerce et d'industrie de Paris le prix Espoir de l'économie 2006.
"J'ai beaucoup observé les parcours autour de moi. Certains sont passés de l'autre côté, sont partis en prison et sont revenus changés, ça ne donnait pas envie", se rappelle-t-il.
Il déborde d'énergie et de créativité. Pour la promotion des "Anges s'habillent en caillera", il a passé des nuits à coller 3.000 affiches dans toute la Seine-Saint-Denis. Il court à la rencontre des lecteurs. Prochainement, il va tourner dans le 9-3 dans un van habillé aux couleurs du livre.
Il ne cache pas sa fierté face au succès de son polar. Les 2.000 premiers exemplaires ont été écoulés en quelques jours après sa sortie en janvier. Il y a eu une réédition à 2.000, et il va y en avoir encore une autre, se félicite son éditeur, "Moisson rouge".
Rachid Santaki montre des messages reçus sur Facebook de jeunes qui ne lisent pas d'habitude et qui n'ont pu lâcher son livre. "Ils se reconnaissent dans le langage, dans les personnages, dans les histoires", dit-il. "C'est pour ça qu'avec + Les anges +, le 93 a son premier roman noir", ajoute l'auteur.
"Dans mon entourage, certains étaient choqués que j'écrive un livre aussi sombre alors que je suis très positif", confie-t-il.
"J'avais envie de montrer que moi sorti de nulle part, j'étais capable de faire une fiction originale", explique Rachid Santaki, qui voudrait rencontrer des auteurs reconnus comme Dominique Manotti ou Didier Daeninckx.
jeudi 17 février 2011
Agenda des rencontres avec Rachid Santaki
Vendredi 18 février : à partir de 18h
Dédicace à la Librairie Décitre Part Dieu (centre commercial Part Dieu, niveau 3).
Samedi 19/02 :
Rencontre / débat / projection au bistrot librairie Les Vengeances tardives à partir de 14h au 76 cours Gambetta Lyon 7e (www.les-vengeances-tardives.fr)
Le Van Les Anges s'habillent en caillera sera en tournée en banlieue, grande banlieue et à Paris, du vendredi
25 février au vendredi 11 Mars.
Lundi 21 février :
Rencontre 93 Destins dans le cadre de Banlieusards et alors ? à 19h au Roi du Marché à Saint-Denis.
Le Samedi 5 Mars : à partir de 14h30
Dédicace et diffusion du documentaire sur les Anges à Saint-Denis au Virgin Saint-Denis.
Le samedi 12 mars : à partir de 16h
Signature et lectures à la librairie La Traverse
7 allée des Tilleuls 93120 LA COURNEUVE
 Le dimanche 13 mars : de 10 à 12h
Le dimanche 13 mars : de 10 à 12h
Signature rencontre à la librairie Le Temps retrouvé, à Bagnolet.
Retrouvez Rachid Santaki dans l'émission A plus d'un titre de Tewfik Hakem sur France Culture
Dédicace à la Librairie Décitre Part Dieu (centre commercial Part Dieu, niveau 3).
Samedi 19/02 :
Rencontre / débat / projection au bistrot librairie Les Vengeances tardives à partir de 14h au 76 cours Gambetta Lyon 7e (www.les-vengeances-tardives.fr)
Le Van Les Anges s'habillent en caillera sera en tournée en banlieue, grande banlieue et à Paris, du vendredi
25 février au vendredi 11 Mars.
Lundi 21 février :
Rencontre 93 Destins dans le cadre de Banlieusards et alors ? à 19h au Roi du Marché à Saint-Denis.
Le Samedi 5 Mars : à partir de 14h30
Dédicace et diffusion du documentaire sur les Anges à Saint-Denis au Virgin Saint-Denis.
Le samedi 12 mars : à partir de 16h
Signature et lectures à la librairie La Traverse
7 allée des Tilleuls 93120 LA COURNEUVE
 Le dimanche 13 mars : de 10 à 12h
Le dimanche 13 mars : de 10 à 12hSignature rencontre à la librairie Le Temps retrouvé, à Bagnolet.
Retrouvez Rachid Santaki dans l'émission A plus d'un titre de Tewfik Hakem sur France Culture
vendredi 11 février 2011
mardi 8 février 2011
Mister Kevin Dufrenoy nous fait l'honneur de sa première critique sur Allglorious.com
"Finalement, le plus gros défaut de cet ouvrage, c’est qu’il se lit presque trop rapidement. Un livre puissant, à lire d’urgence, qui m’aura réconcilié avec le goût de la lecture en sommeil depuis… mon entrée en première littéraire ! Excellent travail et bonne continuation Monsieur Santaki."
Kevin Dufrenoy
Retrouvez l'intégralité de la chronique sur :
www.allglorious.com
Agenda Les Anges s'habillent en Caillera
Rachid Santaki sera à Lyon du 18 au 20 février
Le samedi 19/02 :
Rencontre / débat / projection au bistrot librairie Les Vengeances tardives à partir de 14h au 76 cours Gambetta Lyon 7e (www.les-vengeances-tardives.fr)
Le Van Les Anges s'habillent en caillera sera en tournée en banlieue, grande banlieue et à Paris, du vendredi 25 février au vendredi 11 Mars.
Lundi 21 février :
Rencontre 93 Destins dans le cadre de Banlieusards et alors ? à 19h au Roi du Marché à Saint-Denis.
Le samedi 5 mars :
Signature et lectures à la librairie La Traverse
7 allée des Tilleuls 93120 LA COURNEUVE
Le samedi 19/02 :
Rencontre / débat / projection au bistrot librairie Les Vengeances tardives à partir de 14h au 76 cours Gambetta Lyon 7e (www.les-vengeances-tardives.fr)
Le Van Les Anges s'habillent en caillera sera en tournée en banlieue, grande banlieue et à Paris, du vendredi 25 février au vendredi 11 Mars.
Lundi 21 février :
Rencontre 93 Destins dans le cadre de Banlieusards et alors ? à 19h au Roi du Marché à Saint-Denis.
Le samedi 5 mars :
Signature et lectures à la librairie La Traverse
7 allée des Tilleuls 93120 LA COURNEUVE
mercredi 26 janvier 2011
vendredi 21 janvier 2011
Rachid Santaki dans le Parisien
Rachid Santaki affiche son polar urbain
« Les anges s’habillent en caillera » se déroule en Seine-Saint-Denis. C’est le premier roman d’une collection dédiée à la banlieue et lancée par cet auteur du département.
GWENAEL BOURDON | Publié le 21.01.2011, 07h00

SAINT-OUEN, HIER. Comme le font habituellement les rappeurs lors de la sortie d’un album, Rachid Santaki a couvert les murs d’affiches annonçant la parution de son roman. | (lp/G.B.)
Mercredi soir, Rachid Santaki n’a pas dormi. Comme les rappeurs qui veulent annoncer la sortie de leur album, il est allé couvrir d’affiches les murs du quartier de la gare à Saint-Denis. Sauf que Rachid ne rappe pas, il écrit. Son roman, « Les anges s’habillent en caillera* » (Editions Moisson rouge), est en librairie depuis hier. Et ses affiches le clament fièrement : désormais, « le 93 a son premier roman noir ».
Le Parisien
Indices :
le parisien,
Moisson rouge,
Rachid Santaki,
roman urbain,
seine saint denis
Inscription à :
Articles (Atom)











